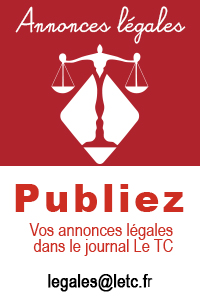Créer une cotisation nouvelle pour financer un minimum de nourriture reviendrait à instituer un financement administratif de la solidarité.
Social. Dans le contexte de la crise de la Covid est née l’idée d’une sécurité sociale alimentaire. Patrick Cases, conseiller régional, y fait allusion et argumente à ce propos dans le dossier Région récemment publié par le TC.
La question de l’accès à l’alimentation est une approche partielle et biaisée des choses. Le vrai problème, c’est celui de la grande pauvreté qui touche plus de 10% de la population et près de 20% des jeunes. Elle se traduit certes par des carences alimentaires, mais bien au-delà par l’impossibilité d’avoir accès à un habitat salubre, à l’énergie, aux soins et aux médicaments, à l’information, à l’éducation, au sport, à la culture et bien sûr à l’emploi. A ce problème global, les idéologues du capitalisme répondent en parlant d’un revenu « décent », filet de sécurité minimal destiné à rendre la misère moins visible et d’autant plus durable. Il y a d’autres solutions, la plus connue étant la charité, pratiquée sous diverses formes depuis le fond des âges. Solution qui a aux yeux du capital le grand mérite de financer la pauvreté par les pauvres eux-mêmes mais qui ne répond en rien à l’idée de solidarité.
Or, créer une cotisation nouvelle pour financer un minimum de nourriture reviendrait à instituer un financement administratif de la solidarité. Certes, des revenus nouveaux, provenant de plus favorisés, seraient mis à contribution. Mais l’expérience a montré que les différentes moutures des « contributions de solidarité » n’avaient en rien diminué l’égoïsme social. Surtout, la taxation du capital et l’ISF, qu’il faut réintroduire, doivent avoir pour ambition le service public dans son ensemble, c’est-à-dire dans son universalité. Une aide ciblant l’alimentation, ce serait la porte ouverte à des contrôles tatillons et humiliants, une concession regrettable aux clichés sur le détournement des allocations familiales (« ils vont le boire ! S’acheter du superflu !) Pourquoi, comme le demandent de nombreuses associations, ne pas favoriser la création de « halles alimentaires » favorisant les circuits courts ?
En outre, il convient de souligner qu’en matière d’alimentation, comme de logement ou de médicaments, on ne peut distribuer que ce que l’on a produit. La condition nécessaire d’une distribution équitable, c’est une production suffisante, en quantité comme en qualité, ce qui suppose des investissements dans la recherche, dans la gestion des terres agricoles, dans le contrôle qualité, dans l’acquisition de compétences et de savoir-faire nouveaux, etc. . Autant dire que manger à sa faim, avoir un toit sur la tête, accéder à l’eau, à l’énergie, aux soins, à l’information, à l’éducation et à tout ce qui fait de la vie autre chose qu’une simple survie, exige une réorientation globale de la dépense publique en direction non pas de la rentabilité financière, mais de l’emploi et de la formation. Une perspective autrement plus ambitieuse et mobilisatrice que le partage de la pénurie.
Contribution de lecteur, Jean-Michel Galano