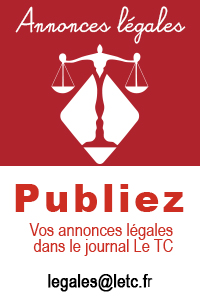Tribune. La conjugaison violences-racisme policier est la forme extrême du racisme d’Etat. Il est en lien avec les pratiques colonialistes et esclavagistes de la France commises au nom d’une prétendue « mission civilisatrice » blanche, chrétienne et/ou laïque.
La question du racisme est revenue et interroge en des termes renouvelés notre société. Nous le devons aux comités et collectifs qui luttent pour les droits des personnes descendant des immigrés du Maghreb ou originaires des territoires ultramarins et d’Afrique. Autant de régions profondément marquées par la colonisation et l’esclavage.
Tout a démarré avec la dénonciation des violences policières et du racisme endémique dans la police. Ces violences avaient déjà pris un tour extrême au cours des manifestations des Gilets jaunes. Mais là, ce qui est visé, c’est la conjugaison violences-racisme. Depuis les années 90, elle a fait l’objet d’enquêtes sociologiques qui montrent qu’on ne rejoint pas la police parce qu’on est violent et/ou raciste, mais qu’on le devient, de par la nature de certaines des missions confiées aux policiers par leur hiérarchie à la demande des autorités étatiques.
Bien sûr que tous les policiers ne basculent pas dans le racisme et la violence, mais le nombre d’entre eux qui en sont affligés est devenu tel, qu’il n’est plus possible de qualifier ces actes d’accidentels ou de conjoncturels. Le phénomène a pris une telle ampleur que l’on peut le taxer de systémique.
Au surplus, ce phénomène se traduit aussi au niveau des préférences électorales des policiers, puisque diverses études ont montré qu’une majorité d’entre eux vote pour le Rassemblement national.
Le racisme d’État sous estimé, voire nié
Les violences et le racisme policier sont la manifestation extrême du racisme d’État. Ce racisme institutionnel infecte toute notre société et se traduit par des stigmatisations quotidiennes et des discriminations de toutes sortes des populations racisées, majoritairement cantonnées dans les cités populaires.
Des populations ciblées en raison de leur couleur de peau, de leurs choix vestimentaires, par exemple le port du voile et de leurs pratiques religieuses, en particulier dans le cas de l’islam. Or, ce racisme d’État est sous estimé, voire nié, au prétexte que la France en aurait été épargnée grâce aux valeurs républicaines qu’elle professe, des valeurs héritières de la philosophie des Lumières et des principes révolutionnaires de 1789.
Réinterroger le concept d’universalisme
Combattre ce racisme d’État, oblige à en révéler les racines historiques et pour ce faire à réinterroger le concept d’universalisme.
Ce concept a donné un fondement idéologique à la soi-disant « mission civilisatrice » de la France chargée de libérer les peuples dit arriérés en leur apportant les lumières de la civilisation blanche et chrétienne, puis, plus près de nous, de sa version républicaine, celle blanche et laïque. Les pires atrocités ont été commises en son nom. Aujourd’hui, les mouvements comme le comité Adama ne se privent pas, à juste raison, de le rappeler.
Pour délégitimer cette contestation, un argument insidieux cherche à s’imposer : en dénonçant l’origine du racisme dont ils sont victimes, les descendant.e.s des peuples colonisés prôneraient un racisme anti-blanc. Certes, ce type de phénomène régressif existe. On le retrouve par exemple avec les relents d’antisémitisme qui se manifestent, heureusement de façon marginale, dans les luttes solidaires avec le peuple palestinien ou contre l’islamophobie.
Aucune complaisance n’est permise, mais cela n’enlève rien à la justesse de ces combats, tout autant qu’au combat antiraciste.
Hiérarchisation par la couleur de la peau
Aujourd’hui, le combat antiraciste doit prendre en compte une réalité sociologique qui contrarie la vision égalitariste de nombreux militant.e.s. C’est la question de la couleur de peau.
Elle s’impose comme un élément déterminant de discrimination sociale, qui opère sans autre médiation. C’est en ce sens que l’on peut parler d’inégalité de race, ce mot étant utilisé, non pour signifier qu’il existerait des races, ce qui serait la pire des inepties, mais pour dénoncer la racisation en tant que mécanisme de stigmatisation par assignation à une différence hiérarchisée. C’est tout à fait différent dans le cas d’une assignation religieuse puisqu’il faut avoir affiché son choix par des signes ostensibles (foulard, kippa, ornements…) dont il est possible, à tout moment, de se séparer.
Comment ignorer que dans leur vécu quotidien, les personnes de peau non-blanche, constatent que celles de peau blanche sont protégées, au moins dans un premier temps, des stigmatisations primaires et immédiates. C’est ainsi qu’il faut comprendre la notion de « privilège blanc », dont les antiracistes blancs ne devraient pas s’offusquer, quant bien même cette notion serait discutable. Les mécanismes du racisme et de la racisation sont bien trop complexes pour écarter une problématique que les antiracistes non-blancs soumettent à notre réflexion.
En tout état de cause, s’il faut écarter une injonction, c’est bien celle d’Emmanuel Macron posant dans son allocution du 14 juin, que de telles approches reviendraient à faire preuve de « communautarisme » et de « séparatisme ».